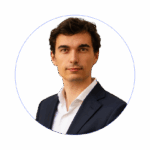Dégradation de la biodiversité : un risque croissant en santé et prévoyance
Dégradation de la biodiversité : un risque assurantiel croissant en santé et prévoyance
La dégradation de la biodiversité dépasse désormais le cadre d’une simple préoccupation éthique et écologique, pour s’imposer comme un enjeu majeur de santé publique et entraîne de nombreuses conséquences financières. En assurance santé et prévoyance, la dégradation de la biodiversité se traduit par une évolution du risque et par l’augmentation des sinistres liés aux maladies infectieuses, aux pathologies chroniques et aux troubles psychosociaux. Face à l’émergence visible de ces risques qui y sont liés, les assureurs ont une opportunité stratégique d’adapter leurs modèles, de repenser leurs produits, et de s’engager activement dans des démarches de prévention intégrées. La perte de biodiversité ne relève plus de la prospective environnementale : elle participe à reconfigurer, dès aujourd’hui, le paysage du risque sanitaire et
social.
Les écosystèmes naturels rendent de nombreux services essentiels à la santé humaine : purification de l’air et de l’eau, régulation des agents pathogènes, production alimentaire, pollinisation, régulation thermique ou encore santé mentale. Selon le rapport « Santé et Biodiversité : Analyse des enjeux pour une approche intégrée » publié en février 2023 par l’Agence régionale de la biodiversité d’Île-de-France, la dégradation des services écosystémiques est associée à une augmentation mesurable des risques sanitaires, notamment via l’exposition accrue aux polluants, aux agents infectieux et aux perturbateurs de l’équilibre psychosocial.
En janvier et juin 2025, ce constat a de nouveau été appuyé et détaillé dans l’étude Santé et Biodiversité, publiée sur le site « Portail de la biodiversité en Centre-Val de Loire ». Ce dossier illustre la manière dont la perte de biodiversité fragilise les écosystèmes et engendre des conséquences sanitaires.
1. Risques sanitaires émergents et sinistralité : une dynamique déjà en action
Les conséquences de la perte de biodiversité ne sont pas hypothétiques. Elles se traduisent aujourd’hui par un développement tangible de certaines pathologies, qui influent sur la sinistralité dans le secteur de la santé et de la prévoyance. De nombreux indicateurs issus des Agences régionales de la biodiversité montrent que ces tendances s’accélèrent fortement depuis une dizaine d’années, complexifiant de ce fait les modélisations actuarielles. Une des particularités du risque lié à la perte de biodiversité est la multiplicité des conséquences qu’elle peut engendrer. Nous
pouvons classifier les risques selon plusieurs catégories détaillées ci-dessous.
Risques santé biodiversité – Maladies vectorielles et zoonoses
La fragmentation des milieux naturels, l’urbanisation diffuse et le changement climatique favorisent la prolifération de vecteurs de maladies : tiques, moustiques, rongeurs, etc. Ces espèces colonisent de nouveaux territoires, favorisant l’émergence de zoonoses, c’est-à-dire des maladies transmissibles de l’animal à l’homme, comme la maladie de Lyme, la leptospirose ou certaines formes de grippe.
Selon le rapport ORS Île-de-France, l’incidence de la maladie de Lyme a augmenté de 20 % en cinq ans dans la région, avec une diffusion vers des zones périurbaines auparavant peu exposées. Ces maladies induisent des soins souvent longs, une errance diagnostique et des arrêts de travail répétés, qui pèsent directement sur les régimes santé et prévoyance.
Le moustique tigre représente aujourd’hui un risque croissant. Implanté dans plus de 70 % des communes françaises, il est responsable d’une forte recrudescence de chikungunya en 2025. Depuis le début de l’été, 570 cas ont été recensés, répartis sur 65 foyers actifs à l’échelle nationale d’après l’agence Santé publique France. Des foyers de plus de 50 cas ont notamment été identifiés dans certaines villes du sud de la France, ce qui a motivé d’importantes campagnes locales de démoustication, comme le rapporte la mairie de Bergerac. Transmise également par le moustique tigre, la dengue fait actuellement l’objet d’une surveillance étroite. D’après l’Institut Pasteur, 21 cas ont été recensés sur le territoire en septembre 2025. Sans atteindre l’ampleur épidémique du chikungunya, cette maladie présente toutefois un potentiel de développement important, avec des formes graves susceptibles de nécessiter une hospitalisation.
Pour les assureurs, la dengue est un risque émergent encore difficile à modéliser. Publié en mars 2025, le rapport de recherche de Stéphane Loisel, Adeline Stephan et Rayane Vigneron souligne que la montée en fréquence de telles maladies vectorielles dans les zones tempérées remet en question les scénarios classiques utilisés en assurance. Ce constat appelle à des ajustements méthodologiques importants dans la construction des modèles de risque en santé. L’approche linéaire ne suffit plus, il faut intégrer des dynamiques plus complexes et prendre en considération des incertitudes épidémiologiques, et des effets systémiques associés à ce type d’épidémies. La dengue devient ainsi un révélateur supplémentaire de la nécessité d’ajustement de nos cadres d’analyse.
Risques santé biodiversité – Espèces végétales invasives et allergies
La plateforme Biodiversité Centre-Val de Loire confirme, par exemple, une expansion vers le nord de l’ambroisie à feuilles d’armoise, favorisée par le réchauffement climatique et les perturbations agricoles. Il s’agit d’une espèce invasive dont le risque allergène est particulièrement préoccupant. Elle produit plus d’un milliard de grains de pollen par pied et ses graines restent viables dans le sol pendant plus de 40 ans ce qui rend toute éradication complexe et génère des conséquences sanitaires durables. Cette dynamique s’accompagne d’une hausse continue des consultations pour asthme, rhinites et allergies. La perte économique ici est double : d’un côté via le coût direct des soins et de l’autre via l’absentéisme professionnel associé.
Risques santé biodiversité – Troubles psychiques liés à l’érosion du vivant
Le lien entre santé mentale et contact avec la nature est de plus en plus documenté. Selon l’ORS Île-de-France, le contact régulier avec la nature diminue significativement le stress, l’anxiété et la dépression. À l’inverse, la disparition des espaces verts urbains engendre une hausse des troubles anxieux et dépressifs, en particulier chez les jeunes adultes. Ces pathologies, chroniques et invalidantes, entraînent des arrêts longs et coûteux, affectant les prestations d’invalidité et les risques lourds en prévoyance. De plus, nous pouvons noter un enjeu lié à la dépendance pharmacologique. A titre d’exemple, 85 % des traitements anticancéreux mis au point depuis 1981 sont issus du monde naturel. À mesure que des espèces disparaissent, ces ressources thérapeutiques s’amenuisent.
Risques santé biodiversité – Exposition croissante aux espèces dangereuses
Le développement d’espèces dangereuses comme la chenille processionnaire constitue une menace sanitaire grandissante, ayant des effets toxiques documentés : urticaires, complications oculaires, allergies sévères. Leur aire de répartition s’élargit rapidement sous l’effet du changement climatique, jusque dans les zones urbaines. Ces risques entraînent une hausse des consultations d’urgence et de soins spécialisés, alourdissant la sinistralité dans certains territoires. Pour aller plus loin, cette menace touche aussi les animaux de compagnie, particulièrement exposés : une ingestion ou un simple contact avec certaines espèces peut être fatal sans prise en charge vétérinaire immédiate. Sur le plan assuranciel, ceci engendre une hausse des sinistres dans les zones concernées et doit être pris en considération dans la tarification des produits d’assurance animale.
L’intensification des risques sanitaires liés à la perte de biodiversité ne relève plus du simple constat scientifique. Elle modifie déjà la structure de la sinistralité. Face à ce mouvement, les assureurs ne peuvent plus se contenter d’une posture passive. Il devient pertinent d’adapter les modèles de risque, d’évoluer vers une assurance plus préventive, et d’actionner l’ensemble des leviers propres au métier. Ces ajustements ne relèvent plus uniquement de l’innovation, ils deviennent aujourd’hui un enjeu de soutenabilité économique.
2. Repenser les modèles, les produits et définir les leviers de résilience face à la dégradation de la biodiversité
La perte de biodiversité, en agissant comme catalyseur des risques sanitaires, exige une révision des modèles assurantiels. En tant qu’assureur, acteur de prévention et investisseur institutionnel, le secteur détient des leviers d’action structurants pour répondre à ces enjeux.
Adaptation des modèles de prévision et de gestion des risques
L’augmentation de certains risques, tels que les pathologies vectorielles, troubles psychiques, allergies environnementales, rendent incomplètes les hypothèses actuarielles classiques liés à la gestion de sinistralité. En effet, ces derniers peinent aujourd’hui à intégrer à leurs outils :
- la non-linéarité des phénomènes (par exemple, la propagation accélérée de l’ambroisie ou des tiques),
- la localisation des expositions (différencier les zones urbaines pauvres en biodiversité, territoires en tension écologique),
- l’enjeu systémique des risques environnementaux, avec les effets en cascade provoqués sur la santé.
Sur un plan plus technique, les modèles actuariels doivent notamment évoluer vers :
- l’intégration de variables environnementales (qualité des sols, pollens, artificialisation, fragmentation des milieux) dans les scénarios de projection,
- l’enrichissement de bases statistiques avec des données de santé publique, et des observations environnementales,
- des travaux sur les interdépendances spatiales et temporelles, via des modèles dynamiques, notamment sur les pathologies chroniques ou liées à l’environnement.
L’EIOPA a d’ailleurs alerté les assureurs de la place sur ce point en mentionnant que la robustesse des portefeuilles repose désormais sur la capacité des assureurs à anticiper les risques environnementaux émergents dans leurs modèles de tarification.
Évolution des produits et des garanties de santé et prévoyance
Pour assumer pleinement son rôle, l’assureur doit concevoir ses produits de santé et de prévoyance en tenant compte de cette nouvelle réalité sanitaire. La montée en puissance des affections allergiques, des maladies vectorielles et des troubles psychiques exige une adaptation concrète des garanties. Parmi ces dernières, on retrouve :
- la création de produits ciblés couvrant les pathologies environnementales ou saisonnières (allergies, maladies vectorielles, etc.) avec des accompagnements dédiés,
- le renforcement ou réévaluation des couvertures de prévoyance face aux arrêts de travail longue durée liés à des affections psychiques ou à des maladies chroniques aggravées par l’environnement,
- le développement de services intégrés de prévention : alertes environnementales (pollen, qualité de l’air), bilans de vulnérabilité écologiques, éducation thérapeutique propre à l’environnement de vie de chacun,
- la territorialisation des offres : ajustement des couvertures selon l’exposition locale (zones infestées de chenilles processionnaires, d’ambroisie ou de tiques).
Cette évolution s’inscrit dans un repositionnement de l’assureur en acteur de santé publique territoriale, capable d’anticiper et d’amortir les conséquences du dérèglement écologique et biologique.
Mobilisation de l’investissement pour agir sur les causes de la dégradation de la biodiversité
Dans son rôle d’investisseur, l’assureur détient un pouvoir d’action : il peut orienter ses capitaux pour agir en amont des risques, en finançant la préservation ou la restauration de la biodiversité. Plusieurs pistes d’action s’ouvrent à lui :
- Investir dans des solutions fondées sur la nature (nature-based solutions), la renaturation des milieux urbains, ou les infrastructures éco-conçues.
- Se désengager progressivement des secteurs fortement destructeurs du vivant (agriculture intensive, vastes infrastructures linéaires et non compensées, industries extractives, etc.).
- Créer ou investir sur des produits financiers à impact biodiversité : obligations vertes liées aux écosystèmes, fonds à impact local, projets de régénération écologique.
- Intégrer de manière systématique des critères biodiversité dans les politiques ESG, en phase avec les attentes réglementaires européennes, dont la Taxonomie européenne et les principes de double matérialité.
En agissant en amont des dégradations écologiques, l’assureur-investisseur réduit son exposition aux risques de transition, tout en consolidant la soutenabilité globale de son portefeuille. Il profite ainsi d’un important levier d’optimisation actif/passif en profitant d’un bénéfice financier de moyen et long terme, issu de l’ensemble des actions de prévention qu’il aura menées en amont Cette mutation du secteur, bien que fondée sur des initiatives stratégiques et volontaires, s’inscrit désormais dans un cadre réglementaire de plus en plus structurant. L’EIOPA, la Commission européenne et les autres autorités de supervision exigent des assureurs qu’ils prennent en compte les risques liés à la biodiversité, non seulement dans leur analyse actuarielle ou leurs investissements, mais aussi dans leurs processus de gouvernance. L’évolution vers une gestion durable du vivant n’est donc plus uniquement souhaitable, elle devient normative.
3. Intégration dans les processus normatifs : vers une réglementation structurante
L’intégration du risque lié à la biodiversité dans les processus réglementaires européens n’est plus une perspective lointaine, c’est une dynamique déjà engagée, notamment portée par l’EIOPA. L’institution européenne accroît ses attentes vis-à-vis des acteurs de l’assurance sur les enjeux de biodiversité, tant du point de vue de la gestion des risques que des obligations de transparence. Deux documents structurants ont paru au cours de cette dernière année : une consultation sur le « plan de gestion des risques liés à la durabilité des assureurs », ainsi que le « rapport sur la gestion des risques liés à la biodiversité par les assureurs », respectivement publiés par l’EIOPA en décembre et juin derniers. La majorité des assureurs n’intègrent encore que très partiellement les risques liés à la biodiversité dans leur analyse d’exposition et sont invités par le régulateur à progressivement améliorer leur approche en termes d’identification, de cartographie et de mesure du risque, en s’appuyant sur des référentiels partagés tels que :
- l’identification des pressions sur la biodiversité selon les catégories IPBES (changement d’usage des sols, pollution, espèces invasives, etc.),
- la cartographie des dépendances, notamment via l’outil ENCORE* ou les bases TNFD,
- l’intégration de métriques biologiques dans l’analyse de portefeuille (indice de condition des écosystèmes, nombre d’espèces menacées, etc.).
Ce travail analytique est désormais considéré comme socle indispensable à une gestion efficace des risques assurantiels, physiques comme de transition.
L’EIOPA précise que les actifs exposés à des secteurs exerçant une influence négative sur la biodiversité (extraction, infrastructures linéaires, agriculture intensive, etc.) devraient faire l’objet d’une analyse renforcée, voire d’un plan d’atténuation.
Mise en cohérence avec les cadres européens
Les initiatives de l’EIOPA s’inscrivent dans un cadre réglementaire européen plus large, dans lequel la biodiversité devient une composante structurelle de la gestion des risques de durabilité. A l’échelle européenne, on retrouve :
- la CSRD qui exige, dès 2025 pour les grandes entreprises, un reporting sur les risques et dépendances liés à la nature,
- la SFDR qui impose aux produits financiers de préciser la manière dont ils prennent en compte les facteurs de durabilité, y compris les atteintes à la biodiversité,
- le cadre de la TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) qui, sur contribution volontaire, sert de matrice à plusieurs des exigences énoncées par l’EIOPA.
De manière concrète, pour les assureurs, cela signifie qu’un alignement rapide sur ces standards est non seulement stratégique mais prudentiel, en prévision de futures obligations de conformité. Plus que des contraintes formelles, ces évolutions réglementaires traduisent une attente explicite vis-àvis du secteur : celui d’assumer pleinement son rôle dans la transition écologique, en intégrant la protection du vivant comme paramètre structurant de sa stratégie globale.
Ce changement de posture implique de renforcer la transversalité entre fonctions risques, RSE, investissements et actuariat, de considérer la biodiversité comme un risque systémique, au même titre que le climat, mais également de positionner l’assureur comme acteur de stabilisation écologique, capable d’agir sur les causes autant que sur les conséquences. Le régulateur ne demande pas encore des résultats chiffrés immédiats, mais il exige une démonstration claire de trajectoire : identification des expositions, plans d’action, engagement dans la transparence, et prise en compte explicite de la biodiversité dans les décisions de gouvernance.
4. Stress-tests liés à la nature : anticiper les chocs systémiques liés à l’érosion du vivant
Les stress-tests liés à la nature marquent une évolution significative dans l’appréhension des risques systémiques environnementaux par les institutions financières. A l’instar des stress-tests climatiques, un stress-tests « dégradation de la nature » a pour objectif de simuler les effets macroéconomiques et financiers d’une dégradation sévère, parfois irréversible, des services écosystémiques.
Portés par plusieurs banques centrales, dont la Banque centrale des Pays-Bas et la Banque de France, ces exercices consistent à modéliser des scénarios de rupture écologique : effondrement de la pollinisation, épuisement des sols, disparition d’espèces-clés ou politiques de protection renforcées. Ils visent à déduire les conséquences économiques à moyen terme sur la croissance, l’emploi, la stabilité des prix, mais aussi sur la santé publique et les équilibres sociaux. Ces stresstests n’ont pas vocation à prévoir l’avenir, mais à révéler les vulnérabilités structurelles d’un système économique exposé à des dynamiques écosystémiques instables. De tels scénarios appellent à une lecture transversale des interdépendances entre le vivant et l’économie, dont la résilience dépend directement de la qualité et de la continuité des services rendus par les écosystèmes.
Pour les assureurs, l’intérêt de ces exercices est double. D’une part, ils permettent d’intégrer des paramètres aujourd’hui absents de nombreux modèles actuariels, en particulier les effets non linéaires ou cumulatifs des dégradations environnementales. D’autre part, ils fournissent un cadre d’anticipation opérationnelle, utile pour ajuster les hypothèses de projection, identifier les poches de vulnérabilité dans les portefeuilles, ou renforcer les mécanismes de couverture.
Des scénarios de dégradation de la biodiversité déjà opérationnels aux Pays-Bas
La Banque centrale des Pays-Bas (DNB), en partenariat avec l’Institut PBL et l’Université de Wageningen, a publié fin 2023 une première série de stress-tests « dégradation de la nature » reposant sur cinq scénarios contrastés. Quatre d’entre eux modélisent des transitions politiques ou réglementaires (suppression des subventions nuisibles, taxation des produits issus de la déforestation, extension des zones protégées, etc.), tandis qu’un cinquième anticipe un choc physique lié à l’effondrement de la pollinisation. Les résultats obtenus démontrent des conséquences économiques tangibles. Par exemple, dans le scénario de suppression des subventions agricoles, une baisse du PIB néerlandais d’environ 3 % est projetée deux ans après le choc. Du côté des institutions financières, les assureurs et fonds de pension apparaissent exposés à des pertes de valeur significatives dans les scénarios les plus sévères : -3 % en moyenne pour les assureurs, -5,3 % pour les caisses de retraite. Ces estimations confirment que la dégradation des écosystèmes constitue un enjeu financier mesurable.
La DNB souligne cependant plusieurs limites méthodologiques : les scénarios sont encore largement monofacteurs, les effets de court terme sont sous-estimés, et la modélisation des risques non linéaires reste partielle. Pour autant, ces premiers exercices fournissent une première base précieuse qui démontre la faisabilité et l’intégrabilité technique de tels stress-tests dans les mécanismes de gestion de risques actuels.
Vers une modélisation macroéconomique coordonnée sur le territoire français
La Banque de France s’est engagée depuis 2024 dans un processus structurant visant à formaliser une modélisation macroéconomique des risques liés à la nature. Dans un rapport publié en août 2024, l’institution dresse un état des lieux critique des modèles économiques disponibles : trop centrés sur le climat, souvent incapables de représenter les dépendances sectorielles aux services écosystémiques ou d’intégrer les rétroactions sanitaires et sociales. Ce constat a motivé la création, en juin 2025, d’un groupe de travail sur la modélisation des risques liés à la nature. Ce groupe, réunissant économistes, écologues, institutions financières et superviseurs, a pour mission de développer des scénarios standardisés, robustes, et compatibles avec les cadres réglementaires européens (CSRD, SFDR, TNFD). L’objectif est de produire, dès 2026, des outils opérationnels permettant aux acteurs financiers, y compris assureurs, d’intégrer les stress-tests liés à la nature à leur stratégie prudentielle. Parmi les chantiers engagés figurent :
- la création de référentiels sectoriels de dépendance au vivant, afin de cartographier l’exposition réelle des portefeuilles,
- l’amélioration des modèles intégrés en y associant des paramètres sanitaires, alimentaires et sociaux,
- l’élaboration de scénarios différenciés selon les régions, les filières économiques ou les dynamiques de dégradation écologique.
Cette approche vise à fournir aux acteurs assurantiels des éléments concrets pour adapter leur modélisation des risques, en y intégrant les dimensions systémiques, territorialisées et transversales liées à l’érosion du vivant.
Conclusion sur les enjeux liés à la dégradation de la biodiversité santé et prévoyance
La dégradation de la biodiversité n’est plus une menace lointaine : elle détériore déjà la santé des populations et la sinistralité des assureurs. Ce constat exige une transformation rapide des modèles, produits et stratégies d’investissement du secteur. Les stress-tests liés à la nature offrent un cadre structurant pour mesurer et anticiper les chocs systémiques liés à l’érosion du vivant. Ils permettent aux assureurs de mieux comprendre leurs expositions, d’adapter leurs pratiques et de
renforcer leur résilience face à ces risques complexes.
Les initiatives récentes, aux Pays-Bas et en France, montrent que cette démarche progresse concrètement, soutenue par des exigences réglementaires européennes strictes. Dans ce contexte, l’assureur doit pleinement assumer son rôle d’acteur proactif et innovant, combinant performance économique, responsabilité écologique et engagement envers ses assurés. La pérennité du secteur dépend désormais de sa capacité à intégrer la nature, en complément du risque climatique, comme
un facteur clé de stabilité, en incitant les assureurs à protéger la biodiversité en tant qu’élément essentiel à la santé humaine et la résilience de leur propre modèle économique.
Références
ORS Île-de-France – fevrier 2023
Portail biodiversité Centre-Val de Loire - juin 2025
Santé publique France – septembre 2025
Institut Pasteur – septembre 2025
Loisel et al. – mars 2025
ACPR – janvier 2025
EIOPA - décembre 2024
EIOPA - juin 2025
Banque de France - août 2024
Banque de France - juin 2025
Banque des Pays-Bas - décembre 2023